Larguer du fer dans l’océan : le dangereux déploiement d’une technique de géoingénierie
5 décembre 2025
5 décembre 2025
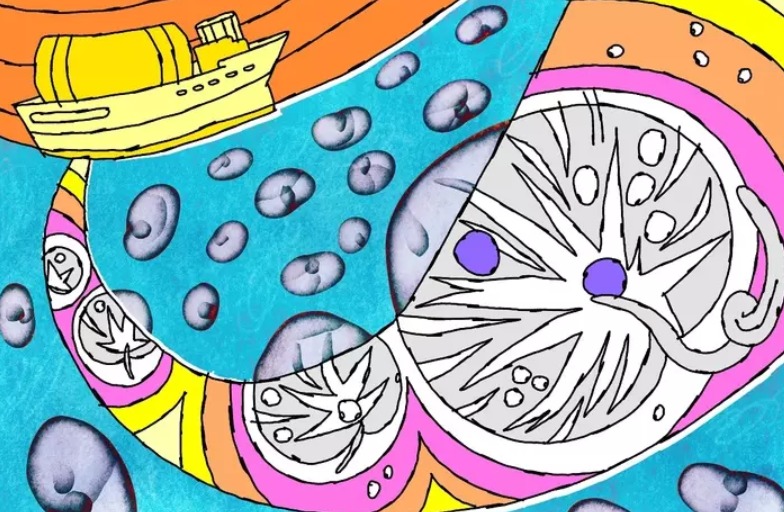
L’idée de déverser des tonnes de fer dans l’océan pour nourrir du phytoplancton absorbeur de CO2 revient à la mode. L’efficacité de cette méthode n’est pourtant pas prouvée, et elle risque d’être désastreuse pour les écosystèmes.
C’est un projet démiurgique que les scientifiques avaient remisé au placard, mais qui revient en force, depuis quelques mois. Fertiliser l’océan. Sur le papier, l’idée pourrait sembler alléchante : on déverse des tonnes de nutriments — essentiellement du fer — dans l’océan, pour y faire croître le phytoplancton, lequel, en se développant, absorbe du CO2 issu de l’atmosphère. Ce qui réduit ainsi l’effet de serre et contribue à diminuer l’intensité du changement climatique.
Sauf qu’évidemment, dans le vrai monde, les choses sont plus compliquées. Dans les années 1990 et 2000, de nombreuses études, modélisations et pas moins de treize expérimentations de terrain à petite échelle avaient donné des résultats mitigés. La très incertaine efficacité climatique de l’opération, doublée de risques multiples pour la biodiversité, avaient contribué à faire retomber l’engouement pour la fertilisation.
Jusqu’à aujourd’hui. Dopés par le développement des marchés carbone, de plus en plus d’acteurs économiques s’intéressent au concept de fertilisation de l’océan, qui risque d’échapper complètement au contrôle des scientifiques.
En janvier 2025, la startup israélienne Gigablue s’enorgueillissait ainsi d’avoir conclu le plus gros contrat en la matière : la vente de 200 000 crédits carbone à l’entreprise SkiesFifty, spécialisée dans l’aviation « durable », contre la promesse de séquestrer par la fertilisation 200 000 tonnes de CO2 dans l’océan en quatre ans.
Derrière Gigablue, de nombreux autres candidats frappent à la porte. « Je suis complètement hallucinée de voir la vitesse à laquelle ça émerge, témoigne l’océanographe biogéochimiste Marion Fourquez, spécialiste des processus de fertilisation de l’océan. Depuis un an, je me suis fait démarcher par de nombreuses startups qui maîtrisent mal le sujet. Sans parler des innombrables conférences et articles que l’on voit passer ces derniers mois. »
Hélène Planquette, chercheuse au Laboratoire des sciences de l’environnement marin, voit aussi se multiplier les initiatives douteuses, venues des États-Unis et d’Asie notamment. « Lors de la conférence de l’ONU sur l’océan [en juin 2025, à Nice], on a vu passer des choses hallucinantes, des présentations qui prétendent que ces méthodes de géoingénierie marchent en ayant fait peu, voire aucune étude d’impact », dit-elle.
De fait, cette effervescence de marchands se targuant abusivement de vendre des technologies « scientifiquement prouvées » peine à être régulée. Le protocole de Londres, conclu en 1996, réglemente la gestion des déchets en mer entre les plus de 50 États signataires. Un amendement à ce protocole, adopté en 2013, interdit « toutes les activités de fertilisation de l’océan » hors « travaux de recherche scientifique légitimes ». Mais cet amendement n’est pas entré en vigueur, de nombreux États, dont la France, ne l’ayant pas encore ratifié.
Il faut dire que les startups ne sont pas les seules à lorgner sur la fertilisation. Toutes les technologies d’élimination du CO2 atmosphérique, dont celles basées sur l’océan, suscitent un intérêt institutionnel croissant.
En arrière-fond : la prise de conscience que le dépassement des 1,5 °C de réchauffement climatique est désormais inévitable, par l’inaction coupable des États. Dans tous les scénarios du Giec, la seule manière d’espérer revenir sous ce seuil de viabilité climatique implique donc de recourir à des techniques d’élimination du carbone, en complément de la baisse drastique de nos émissions.
Mais la fertilisation de l’océan peut-elle être une bonne candidate pour cela, malgré les risques et incertitudes qui l’entourent ? Du côté de la communauté scientifique, les avis divergent sur l’attitude à adopter. Certains, notamment dans le monde anglo-saxon, se remettent à étudier en détail ces technologies, et les rapports d’institutions scientifiques se sont empilés ces dernières années. L’argument central étant qu’il faut lever les incertitudes, identifier les potentiels atouts et dangers, et ne pas abandonner l’expertise aux seuls lobbies industriels.
D’autres estiment qu’on en sait assez et que poursuivre la recherche reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, conduisant au déploiement inéluctable de projets dangereux. L’Académie des sciences, dans un rapport publié en octobre, s’inquiétait également de ces fausses « technologies miracles » qui risquent de devenir des « leurres climatiques », servant de prétexte à l’inaction et détournant l’attention des efforts de réduction des émissions de CO2.
Les raisons d’être sceptique sont nombreuses. Un rapport de 2023 de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) évalue la capacité de séquestration du CO2 par la fertilisation entre 0,1 et 1 milliard de tonnes (Gt CO2) par an environ. L’Académie des sciences étasunienne avance quant à elle l’estimation de 3,72 Gt CO2 par an comme « maximum théorique potentiel ». Soit un potentiel marginal comparé aux plus de 40 Gt CO2 que le monde émet chaque année.
« Si vous êtes carencé en fer, lécher un clou rouillé ne vous sera pas très utile »
Si la fourchette des estimations est large, c’est parce que les résultats ont pu être extrêmement variables d’une expérimentation à l’autre, traduisant l’énorme complexité des processus biogéochimiques impliqués. Il faut réaliser la fertilisation dans une zone océanique carencée en fer mais riche en autres nutriments, et avoir une bonne pénétration lumineuse, entre autres critères.
Sans compter que tous les types de fer ne se valent pas. « Si vous êtes carencé en fer, lécher un clou rouillé ne vous sera pas très utile : votre organisme ne peut absorber que des formes spécifiques de fer rendues biodisponibles dans des gélules contenant les bonnes molécules. C’est pareil pour le phytoplancton, », explique Marion Fourquez.
« Balancer du sulfate de fer, par exemple, ne remplacera jamais les ligands organiques naturels qui stabilisent le fer et le maintiennent en surface sous des formes plus assimilables », poursuit-elle.
Quand bien même la fertilisation en fer permettrait au phytoplancton de croître en captant massivement du CO2, encore faut-il que celui-ci finisse par couler dans les abysses, pour y piéger le carbone pendant des milliers d’années. Or, une part conséquente pourrait refaire surface en quelques semaines ou mois seulement, relarguant le CO2 dans l’atmosphère au passage.
Pire encore, la fertilisation pourrait relâcher plus de gaz à effet de serre qu’elle n’en capte ! La stimulation du phytoplancton pourrait, indirectement, augmenter les émissions de protoxyde d’azote et de méthane, de très puissants gaz à effet de serre. Le fer déversé pourrait aussi nourrir certaines bactéries qui, contrairement au phytoplancton, relâchent du CO2 au lieu d’en capter.
Si tous ces risques étaient levés, il resterait à établir le bilan carbone et écologique global d’une opération logistique gigantesque. En octobre 2025, un rapport des ONG Les Amis de la Terre et The Center for International Environmental Law, évaluait les besoins d’une opération de fertilisation conséquente à la mobilisation de milliers de navires fertilisant 10 à 20 % de la surface de l’océan, 15 fois par an. Et ce, tous les ans sur des décennies. Sans parler des pollutions engendrées par le minage et le transport du fer.
La biodiversité, enfin, pourrait pâtir des effets secondaires de telles interventions. Stimuler la production de phytoplancton dans une zone risque de perturber la circulation naturelle des nutriments, et par ricochet, d’affecter le développement d’écosystèmes situés dans d’autres régions du globe. De plus, l’ajout de fer pourrait favoriser le développement de certaines espèces au détriment d’autres, « créant des déséquilibres potentiels dans l’ ensemble de la chaîne alimentaire », dit Hélène Planquette.
Le fer déversé pourrait par exemple favoriser certains phytoplanctons en défavorisant le développement du krill, des petits crustacés à la base de l’alimentation des manchots, phoques et autres baleines. Ou entraîner une prolifération d’algues toxiques pour les oiseaux marins.
Les partisans de l’accélération de la recherche ne sont pas effrayés par ces considérations. Au contraire, les effets délétères incertains de la fertilisation sont « exactement la raison pour laquelle nous devons mener des études pilotes [dans l’océan], qui ne s’approchent pas de l’échelle commerciale mais soient suffisamment large pour nous fournir des résultats significatifs, et que la société puisse faire un choix éclairé », justifie ainsi le chercheur Ken Buesseler.
Chimiste de l’environnement marin à la Woods Hole Oceanographic Institution, épicentre de la recherche sur la fertilisation de l’océan aux États-Unis, il est également directeur exécutif du regroupement international de recherche Exploring Ocean Iron Solutions (ExOIS).
Ce groupe espère déverser dans les années à venir du fer sur une surface océanique de 30 km². L’échelle nécessaire, selon eux, pour obtenir des réponses. L’opération pourrait se dérouler dans le Pacifique nord. De quoi inquiéter les communautés côtières en Alaska, qui se sont émues le 6 novembre dernier, des risques potentiels pour les écosystèmes de telles expérimentations au large de leur territoire.
Les chercheurs de ExOIS leur ont répondu en assurant qu’il était essentiel de construire une science éthique et une gouvernance impliquant les communautés locales. « La demande commerciale de captage du carbone en mer explose, les ventes de crédits atteignant déjà 795 000 tonnes à la mi-2025. […] Si la demande du marché mondial devance une gouvernance saine, il sera trop tard pour rétablir la confiance », écrivent-ils.
En 2025, pendant ce temps-là, les émissions de CO2 dans l’atmosphère ont continué d’augmenter, dépassant les 42 Gt CO2 annuelles. Plus cette dette climatique s’aggrave, plus les dilemmes de ce genre risquent de se multiplier, au large de l’Alaska et ailleurs.